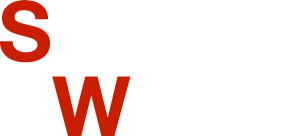Je m’appelle Marie-Pierre Bonniol. Je suis née en 1978. En 1993, juste avant d’avoir mes 15 ans, je réalise mon premier fanzine, une feuille photocopiée recto-verso, qui allait suivre les exemplaires uniques des journaux que j’avais pu faire enfant. J’aime Noir Désir, les Doors et les Sheriff. Je lis la rubrique « Ici et indépendant » du journal Best. J’achète Abus Dangereux parce que Bertrand Cantat fait la couverture. Je vais voir le Centre Jeunesse dans le centre de Marseille, je leur dis que je veux faire un fanzine. Ils me donnent quinze jours pour le faire, je reviens avec ma feuille. Je fais un fanzine.
La feuille s’appelle Zik-Zine, et dès son deuxième numéro, il s’épaissit déjà d’articles, d’humeurs et d’auteurs invités. J’interviewe les Little Rabbits et Jad Wio. Je prends en photo Raymonde et les Blancs-Becs. Un fanzine punk de région parisienne, Are you a Man or are you a mouse, décide de m’introduire dans ses réseaux et m’insère dans une boucle de flyers photocopiés circulant par courrier qui me fait recevoir des productions punk, grind, hardcore, que je vais chroniquer. Je parle de groupes marseillais comme de hardcore australien ; je parle de Fugazi, Nomeansno, God is my co-pilot, Drive Blind. Je contacte dans Abus Dangereux des groupes dont les démos m’intéressent et chronique tout ce que je reçois. Mes premiers fiancés aiment Sonic Youth, New Model Army, Jeff Dahl, jouent dans les Shaking Dolls, Prohibition. Je vais voir des groupes à Paris en gros pull en laine et en docs coquées. J’interviewe tous les musiciens qui m’intéressent. Je ne roule pas des pelles à tous. Mes notes de téléphone sont astronomiques. Je poste du courrier tous les jours. Je fais huit numéros. Je fais des fanzines.
Mais qu’est-ce qu’un fanzine ? D’abord du papier, et tout ce qui va avec : des agrafes, une agrafeuse si possible le plus grand modèle, des enveloppes, un pèse-lettre, des timbres que l’on encolle pour pouvoir les laver (faire partir le tampon) et les réutiliser. Des tonnes de petits flyers qu’on met dans les enveloppes et qu’on fait circuler. Une machine à écrire, d’abord, avec de la colle qui permet de monter la maquette ; un petit ordinateur Mac, ensuite, qui permet de sauvegarder, revenir et modifier ce qu’on écrit, avec une mémoire RAM tellement faible qu’il me fallait fermer Word pour pouvoir imprimer. Une imprimante à jet d’encre, laborieuse et bruyante, aussi. Je n’utilise pas encore internet et toute ma logistique passe par le papier : photocopies, reliure, encre sur les doigts, odeur de toner, des milliers de photocopies faites près des universités, à côté d’étudiants en médecine. Souvent mon mercredi après-midi ou mon samedi entier.
Mon livret A d’enfance me sert de banque : j’y dépose les chèques de commande que je reçois, et retire la petite trésorerie dont j’ai besoin pour tourner. Je n’ai pas 18 ans et pas accès aux chéquiers. Une petite subvention du centre jeunesse, au tout départ, me donne confiance et me permet de démarrer. J’achète un enregistreur à mini-cassettes. Mes plus beaux cadeaux de Noël : un massicot et même une année une vieille photocopieuse, l’ancienne machine d’un joueur de foot de Monaco : le superbingo. Je peux faire mes fanzines, mes petits flyers à la maison.
Par les fanzines, j’aime par la toile, avant même qu’internet soit entré dans mon foyer ou plutôt, encore à l’époque, la maison familiale . J’explore les goûts des artistes que j’aime : je découvre Fugazi et Télévision par Noir Désir, toute une scène free et branque à la lisière de l’art par Sonic Youth, et tout un paquet d’autres choses lo-fi. Je sors des compilations cassettes que je duplique une par une sur une double platine cassettes. Dans l’une d’entre elle, il y a un morceau de Peter Parker, le projet de Michel Cloup dont le 45 tours sur Cornflakes Zoo, label bordelais, m’avait fortement emballée. Dans une autre compilation, un morceau des mecs qui allaient former Tortoise. Ou des morceaux d’Héliogabale, probablement ma première claque sonique qui allait plus tard me faire tourner la tête vers la no-wave. Les guitares sautillantes des scènes montpelliéraines, toulousaines, ou défendues par les fanzines 21 Again à Marseille, Abus Dangereux à Montauban ou Violence à Saint Etienne ne me suffisent plus. J’ai 16 ans, et les groupes que j’aime m’ont amenée à lire, par leurs noms, leurs noms d’albums, Antonin Artaud comme Adolfo Bioy Casares. L’art, la littérature, les cultures barrées et parallèles, me travaillent de plus en plus. Un nouveau fanzine naît de ces intérêts, Supersonic Jazz, qui durera pendant 3 ou 4 ans et quelques numéros.
Depuis, j’ai eu mille vies et exercé des tas de fonctions dans la musique et le champ artistique et culturel, sans que jamais l’esprit de ces années ne m’abandonne. Les années 90 ont été pour moi le cadre d’une adolescence active où, curieuse de musiques, de productions artistiques, de contacts et d’échanges, j’ai érigé par séries des publications qui, si elles n’étaient reproduites qu’à 200 exemplaires, ont je le sais parfois eu un impact, de la même façon que mes stratégies d’auto-édition m’ont considérablement forgée.
Quel était ce monde parallèle qu’ensemble, à cette époque, depuis nos chambres d’adolescents et de jeunes étudiants, nous édifiions par nos petites publications, nos amours, nos implications ?
Le fanzine, tel que je l’entends, est d’abord une aventure personnelle. Un type avait écrit : “ce ne sont que des mecs de la campagne sans amis.” Ma position première était alors celle-ci : “écrire une correspondance à 200 exemplaires sur le rock”. Le fanzine est avant tout pour moi l’espace de son créateur : qu’il s’agisse des sujets traités comme des choix esthétiques, c’est un espace où peut prendre lieu une subjectivité. A la différence des blogs d’aujourd’hui – je ne parle même pas des réseaux sociaux qui sont pour moi d’une pauvreté affligeante quand aux possibilités d’écriture – le fanzine offre, par son espace fini et l’inscription de cet espace fini dans une temporalité, une possibilité d’éditorialisation que les dispositifs actuels du web, même s’ils sont potentiellement plus ouverts, limitent fortement. Je m’explique : le fanzine offre la possibilité du sommaire, de l’ordre et du séquençage là où les supports sur internet s’organisent désormais en flux, sans espace déterminé et limité dans le temps, sans stratégie de numéros érigés comme ensembles, petites bibliothèques à eux-seuls, mondes en soi, pour quelques numéros.
L’écriture sur internet c’est une écriture que j’aime aussi et que j’ai multipliée, depuis les années 2000, dans différents blogs, essentiellement des carnets, parfois thématiques comme avec Villa Morel, mes recherches préliminaires à Collection Morel, sur les “lieux absolument autres” comme les nommait Michel Foucault dans son petit essai sur les hétérotopies – hétéro autre, topie lieu, les lieux autres. Par leurs sommaires, leurs numéros, leurs éditions envoyées à un moment dans le temps, les fanzines, dans les années 90 étaient autant d’îles accrochés à une adresse / une ville comme à un nom, qui agissaient comme une territorialisation. “J’ai reçu une cassette de Chicago !” ; “Je passe à Thiers, je vais rencontrer Stéphane !”, “Moonstruck viennent de Montpellier !”, “No Pasaran sont de Toulouse !”. Dans les adresses, des impasse des bleuets, des allées fleuries, peu d’adresses d’HLM, quelques résidences d’étudiants. L’imaginaire des fanzines allait avec ses visualisations d’endroits, de chambres et de maisons, où de petits artisans du papier essaimaient leurs goûts dans des cercles sympathisants. Les fanzines sont des petites principautés, qui sont avant tout les règnes d’entières et sincères subjectivités.
Ces subjectivités regroupées, lorsqu’une équipe réelle se forme, se transforment alors en revue et des titres comme Octopus et Ortie, tous deux nés des cendres de la revue Hyacinth, m’ont beaucoup marquée, Ortie développant particulièrement mon goût pour l’art brut et singulier. D’autres journaux, comme Jade de Montpellier, seront des refuges permettant à certains artistes et pratiques artistiques, d’accéder au kiosque. J’écrirai également dans Rock Sound, si possible sur des artistes outsiders, quand j’en aurai la possibilité. Aujourd’hui, ces archives photocopiées, 20 ans après se décomposent. Le papier pâlit, les bords des dossiers deviennent poussière. Le ton que je pouvais y employer ne me correspond plus. Les fanzines, ou cette certaine scène de fanzines des années 90, appartiennent désormais au passé.
Pourtant, en 2016, leur esprit m’habite toujours. Plaisir d’envoyer des objets et plis par la poste. Plaisir des objets physiques qui, plus que par leur possession pure, forment autour de moi un paysage réel, où ce qui constitue mon imaginaire et mon être culturel prend image et forme pour devenir des objets qui me constituent autant que les idées, les inspirations que j’ai pu y trouver. Les objets entrent dans nos vies, l’espace de nos maisons, ses images et nos perceptions se reliant à des moments de nos vies particuliers. Un auteur de fanzines m’a dit : “les vinyls, on peut les enlacer”. Ses fanzines étaient très jolis, photocopiés sur plusieurs couleurs de papier, je les ai gardés. Les auteurs de fanzines expérimentent autant les textes que les formes.
Là où avant je partageais mes goûts comme mon univers, aujourd’hui je fais prendre lieu, se passer : depuis 10 ans je m’occupe de l’agence Julie Tippex qui organise des concerts et des tournées dans l’Europe entière, mettant directement en circulation les paroles et prises artistiques que j’aime. Les dynamiques à l’oeuvre sont, dans des formes différentes, les mêmes : une volonté que les choses circulent, se rencontrent, forment des collections qui puissent à des moments faire sens, résonner entre elles, tisser des poches culturelles, des vues sur l’art, qui participent à l’émergence ou l’expansion de mouvements. Les fanzines, comme toute action de production dans le champ artistique et culturel, façonnent à leur manière l’art en train de se faire en semant, en regroupant, en présentant.
Le commissaire d’exposition Harald Szeemann créait des structures imaginaires, des bureaux, comme autant de tiers pour pouvoir travailler, être en économie, faire se passer, se mettre au travail et en action. Le fanzine, comme dispositif, est un support qui me fascine encore : léger, sans demande particulière d’investissement, aucun besoin de validation, il est un cadre particulièrement privilégié d’auto-énonciation, qui permet à l’écriture de se lancer, mais aussi à son auteur de mettre ses goûts et son être en circuit, dans une économie à l’échelle de son propre monde, sans autre ambition que celle de trouver des galaxies jumelles, des résonances, des points de développement et d’appuis dans ses singularités, à l’écart des stratégies marchandes, en amatorat revendiqué, dans une démarche active et décomplexée quant au rôle qui peut être pris dans le monde, même s’il ne concerne que des micro-groupes, des poches de communautés.
Par les fanzines, j’ai été dans le monde. J’ai écrit, déclaré, partagé. “Ecrire pour ne pas être écrit”, cite l’auteur Enrique Vila-Matas dans un de ses livres (la phrase est de Fogwill, un écrivain argentin) : par les fanzines, par la charge d’enthousiasme et de courage qui les portait comme toute expression d’une subjectivité, j’ai commencé à exister. “Faire” est devenu “Être” et je n’ai cessé depuis de multiplier les projets. Aujourd’hui j’attends un deuxième enfant qui ne saura peut-être pas ce qu’est une édition papier, imprimée, ou imaginer la créer. Mais qui j’espère, comme son grand frère, saura trouver ses propres espaces d’expression, de partage et de créativité ; sa propre manière d’exister.
Berlin – Marseille, octobre 2016
Texte pour la programmation de Bleu Bleu, exposition de Stéphane Arcas et Manuel Pomar à Lieu Commun, Toulouse, dans le cadre du Printemps de Septembre, le 15 octobre 2016